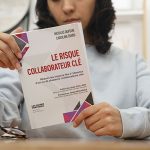Partager la publication "Sérendipité organisée : comment provoquer le hasard dans une ère hybride ?"

1. Comprendre la sérendipité dans l’entreprise hybride
A. Définir la sérendipité organisée en entreprise
Le terme « sérendipité » désigne la réalisation d’une découverte de manière inattendue. Il vient du mot anglais « serendipity », créé par l’écrivain britannique Horace Walpole : il s’était lui-même inspiré d’un conte oriental, Les Trois Princes de Serendip (1754), dans lequel les héros résolvent des énigmes grâce à des découvertes fortuites.
On ne compte d’ailleurs plus les découvertes ayant été le fruit d’un heureux concours de circonstances. La pénicilline trouvée par hasard par Alexander Fleming, l’invention du micro-ondes à la suite d’une expérience imprévue, Christophe Colomb qui tombe sur le continent américain… La sérendipité repose sur deux facteurs : la chance et le hasard.
Toutefois, dans le contexte professionnel, la sérendipité prend une tournure stratégique. Il existe de moins en moins d’occasions de créer ce hasard propice à l’innovation, surtout depuis la démocratisation du télétravail et des messageries instantanées. Pourquoi ?
B. La raréfaction des rencontres fortuites
Le modèle du travail hybride a remodelé les dynamiques. Selon une étude INSEE, en 2022, 55 % des entreprises autorisent une à deux journées de télétravail par semaine. Fini les traditionnels 9h-17h, en présentiel, du lundi au vendredi : l’arrivée du covid a bousculé les codes professionnels, jusqu’à complètement redéfinir les normes… Et réduire les occasions de contacts imprévus.
Cette raréfaction des rencontres, accidentelles ou non, pose un véritable problème. Il devient désormais difficile de se retrouver autour de la machine à café ou de croiser un collègue, et donc de générer de nouvelles idées. Bien sûr, les outils numériques (messageries instantanées, visioconférences, etc.) restent utiles et permettent, parfois, de créer des occasions où le hasard est possible – nous y reviendrons plus tard. Mais la plupart du temps, leur cadre est trop rigide et laissent peu de place à l’inattendu. Il devient donc indispensable de créer des environnements physiques où les rencontres sont encouragées.
C. Le défi de l’innovation dans l’isolement
Ce déficit d’échanges informels n’est pas anodin : ils permettent de véhiculer les idées au sein de l’entreprise. C’est d’autant plus le cas dans les grandes structures, où l’on a tendance à construire ses projets en vase clos, sans forcément communiquer avec les collaborateurs d’autres services. La sérendipité organisée alors comme une solution stratégique pour reconnecter les expertises et les personnes qui, autrement, ne se croisent jamais.
Mais l’enjeu dépasse la seule question de l’innovation : ces moments jouent aussi un rôle majeur dans la cohésion collective. Bien plus que de simples conversations entre collègues, ce sont de véritables vecteurs de lien qui créent un sentiment d’appartenance profond. Croiser un collègue autour de la machine à café a une autre portée que discuter lors d’une réunion, dans un cadre purement formel. Ici, les relations dépassent les échanges fonctionnels, basés sur la productivité et le travail.
2. Sérendipité organisée : comment favoriser les échanges en entreprise ?
A. L’importance du bureau physique pour la sérendipité organisée
Avec cette évolution incontestable du mode de travail, le bureau physique a tout intérêt à s’adapter. Il ne représente plus seulement ce lieu du quotidien où l’on doit se rendre pour effectuer ses tâches : il doit être repensé comme un espace de collaboration.
Cela passe, par exemple, par la création de zones qui encouragent les échanges informels. Salles de brainstorming, cafétérias qui invitent à s’attarder et à converser, coins créatifs, zones de repos, bibliothèques d’entreprise, open-spaces modulables… Il existe de nombreuses solutions pour pousser cette sérendipité si recherchée. L’objectif est de transformer le bureau en profondeur, de l’envisager comme étant un endroit où les salariés ont envie de travailler. Ainsi, les moments anodins peuvent devenir de véritables catalyseurs de discussions productives.
B. Les espaces numériques hybrides
Les dynamiques d’échanges qui existent au bureau peuvent être reproduites, voire amplifiées, dans le monde numérique. Ici, l’enjeu n’est pas de bannir le télétravail, mais de savoir utiliser les outils digitaux comme un véritable levier de connexion humaine. Et pour cause : ils sont désormais importants à tous les niveaux. D’après une étude menée par France Num en 2024, 79 % des dirigeants de TPE et PME considèrent que le digital est un véritable atout pour leur activité, surtout au niveau de la croissance et de la rentabilité.
Pour recréer ces moments informels de la machine à café ou du couloir, il faut donc encourager la création de canaux thématiques. Ces espaces virtuels, centrés sur des passions communes (sport, lecture, cuisine…), permettent aux collaborateurs de se retrouver sans la pression du travail ou de la hiérarchie. Ils deviennent de véritables prolongements de l’espace physique, où le hasard peut opérer et générer des connexions aussi fortes que celles des échanges en personne.
C. La mixité des profils comme moteur de sérendipité
L’entreprise a tout intérêt à cultiver la mixité si elle veut stimuler l’innovation. En effet, les découvertes et les bonnes idées naissent souvent de la rencontre entre des profils variés. Quand des personnes de générations, de métiers ou d’horizons différents se croisent, leurs perspectives divergent et c’est cette friction qui crée de l’étincelle.
Plus l’environnement de travail est hétérogène, plus le hasard a de chances de donner naissance à de nouvelles opportunités. La diversité ne se limite pas à augmenter le nombre d’échanges : elle enrichit leur contenu et agit ainsi comme un véritable incubateur d’idées. Pour orchestrer cette diversité, le rôle des ressources humaines est primordial.
Votre formation INTRA sur ce thème
TRAVAILLER AVEC DES ÉQUIPES MULTICULTURELLES
2 jours – En présentiel ou à distance
- Cartographier les différents modes de communication et les particularités culturelles dans son équipe.
- Adapter sa communication en fonction de l’environnement culturel de son interlocuteur.
- Optimiser la gestion d’une équipe multiculturelle.
- Développer ses compétences culturelles.
3. Le rôle des RH dans la sérendipité organisée
A. La sérendipité comme un pilier de la culture d’entreprise
Cette sérendipité organisée si recherchée ne peut fonctionner sans un changement de mentalité. Certaines structures professionnelles voient d’un mauvais œil les pauses ou discussions sans rapport avec le travail, jugées comme étant une perte de temps et de productivité. Or, sans elles, les chances d’échanger des idées spontanément sont moindres : c’est un manque à gagner à la fois pour l’entreprise, qui réduit son potentiel d’innovation, et pour le bien-être des salariés, qui se sentent étouffés et risquent de partir.
La sérendipité doit donc s’enraciner profondément dans la culture de l’organisation et pour cela, les ressources humaines ont un rôle déterminant. Elles sont là pour montrer l’exemple : en encourageant les rencontres au-delà de l’open-space, en légitimant les échanges qui sortent du cadre professionnel, ou même en reconnaissant la valeur des créations nées du hasard.
B. Créer un climat de confiance pour l’expérimentation
La sérendipité organisée ne peut s’épanouir que dans un climat de liberté et de sécurité psychologique. Les collaborateurs doivent se sentir autorisés à partager une idée, poser une question ou proposer une suggestion sans craindre le jugement. Cela va d’ailleurs de pair avec la culture d’entreprise citée précédemment.
C’est aux RH et aux managers de poser ce cadre bienveillant, où le droit à l’erreur est possible. L’objectif est de libérer la parole et de légitimer la curiosité, soit des moteurs fondamentaux pour que des découvertes fortuites puissent émerger. Ainsi, c’est en dégageant les initiatives de toute pression hiérarchique que les idées inattendues peuvent véritablement naître.
C. L’organisation de rencontres hybrides
La sérendipité organisée est un vrai paradoxe : créer volontairement des moments où le hasard a toute sa place. Là encore, les RH et les managers ont le pouvoir de changer les choses. Il est crucial de mettre en place des dispositifs concrets, pour que les rencontres inopinées deviennent le berceau « d’accidents heureux ».
Comment ? Au quotidien, en revoyant la gestion du travail. Il est essentiel de ne pas surcharger les plannings et de laisser de la flexibilité aux collaborateurs. Quelques minutes autour d’une machine à café ou dans un espace de détente doivent être perçues comme un investissement dans l’innovation, et non comme du temps perdu.
De manière plus occasionnelle, les séminaires sont de parfaits vecteurs de hasard. En réunissant des équipes qui ne se côtoient pas au quotidien, ces événements créent des opportunités de rencontres inattendues. L’organisation d’ateliers, de repas et d’activités en petits groupes permet également de briser les barrières hiérarchiques et de générer des discussions qui n’auraient jamais eu lieu au bureau. C’est en sortant du cadre habituel que l’on donne au hasard la chance de faire émerger des collaborations fructueuses.
Conclusion
Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, la sérendipité organisée n’est pas une contradiction, mais bel et bien une approche stratégique. En repensant les espaces de travail (qu’ils soient physiques ou numériques), en favorisant la diversité et en instaurant une véritable culture d’entreprise, les interactions informelles deviennent de puissants leviers d’innovation et de cohésion. Ici, l’objectif est clair : façonner un environnement où le hasard et les échanges sont les fondations d’une croissance durable.